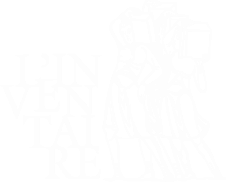A la mort en janvier 1477 de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, le roi de France Louis XI décide d'envahir la province, revendiquant les terres de sa filleule Marie de Bourgogne, fille du Téméraire, alors seule héritière. Les principales places fortes du duché, dont Beaune, restent fidèles à Marie. La ville se révolte ce qui entraîne Louis XI à l'assiéger en mai 1478 pour mater ce soulèvement. Une brèche est rapidement percée par les troupes royales au niveau de la porte Bataillée, point faible de l’enceinte. La capitulation des Beaunois intervient le 2 juillet 1478. Louis XI ordonne la construction d’un château pour assoir son pouvoir et contrôler la population en cas de nouvelles insurrections, à l'instar des citadelles bâties à Auxonne et Dijon.
Un château construit en plusieurs étapes
Ce fort voulu par le roi est situé à l'endroit de la brèche percée par les soldats royaux. Jean Blosset de Saint-Pierre, chambellan du roi et grand sénéchal de Normandie, est chargé du chantier. Les travaux consistent à renforcer la porte (située sur l'enceinte orientale) qui correspond au point de départ de deux routes importantes, une vers Seurre (en direction du Comté) et une vers Dijon. Cette porte est protégée par les tours Blondeau et Renard. L'élaboration de cette citadelle s'échelonne en trois phases comme le démontre Nicolas Faucherre.
Première campagne
Ce premier château a pour dessein de contrôler les Beaunois. Ce fort est alors constitué de trois tours à bossage tournées vers la ville tandis que la porte Bataillée était uniquement défendue par un boulevard de terre et un pont-levis. De forme triangulaire avec une tour en saillie dirigée vers le beffroi, il semble avoir été bâti rapidement afin de parer à toute rébellion. Jean Sandouville en assure le commandement militaire dès 1483. De ce premier édifice, il ne subsiste que les élévations inférieures (casematées) des tours du Diable et Saint-Nicolas adossées à l'enceinte médiévale. Nicolas Faucherre le prouve par l’architecture des ouvertures de tirs "celles tournées vers la ville à l'ouest sont au contraire des arbalétrières-canonnières à double ébrasement ouvrant dans des niches triangulaires sans évents couvertes en arc surbaissé datables de la fin du règne de Louis XI". Il est donc certain que ce château est bien avancé à la mort du roi en 1483.
Seconde campagne
Charles VIII n'apporte pas de grandes modifications dans un premier temps : seuls quelques travaux de réparation sont mentionnés dans les registres des comptes sur la construction des châteaux royaux en Bourgogne vers 1492. Il faut attendre 1494 pour que de nouveaux chantiers de renforcement vers la campagne soient réalisés : couverture du pont et du boulevard devant la porte Bataillée. Toutefois, les améliorations apportées sont toujours davantage concentrées côté ville avec le creusement d'un fossé sec maçonné, franchissable par un pont dormant. Mais dès cette année, une extension vers la campagne s'annonce.
Troisième campagne
En cette année 1494, le registre des comptes indique des dépenses importantes qui portent sur l'agrandissement du château vers l’extérieur. La raison principale est la récente ratification du traité de Senlis en mai 1493 qui entérine la perte du Comté de Bourgogne (future Franche-Comté) au profit de l'Empire : Beaune devient ville frontière. Ce nouveau statut concrétise le projet d’édifier deux nouvelles tours, Madeleine et Saint-Jean. La tour Saint-Jean est la première à sortir de terre. Le registre dit que "maçons et ouvriers" œuvrent à sa construction dès l'été 1494. Jacques de Dinteville est chargé par Charles VIII de mener les travaux, en plus d'avoir été nommé précédemment par le roi capitaine des villes et du château de Beaune. L'édification de la seconde tour Madeleine débute en 1496 ; on conserve dans un premier temps la porte Bataillée tant que le fort n'est pas clos. La tour Saint-Jean est réalisée au cours du règne de Charles VIII. L’achèvement du château est proche lorsque Louis XII lui succède sur le trône : le quinzième compte tenu par Jean Saumaire indique qu'en 1501, il est toujours en cours de construction. Les remparts reliant les tours côtés ville et campagne sont commencés en 1502 sous l'égide du gouverneur de la province, Louis de la Trémouille, d'où la présence du symbole de cette famille (roue armée de faux) sur un des murs. Courtines et tours seront également décorées par les emblèmes royaux, comme les porcs-épics couronnés et les hermines.
Les historiens locaux s'accordent à dire que la finition du château-fort date de 1527, pendant le règne de François 1er. Le travail de Nicolas Faucherre a permis de montrer que ce château fut bien construit en plusieurs temps notamment grâce une étude minutieuse des registres et des formes des ouvertures de tirs, ce qui remit en cause les théories de J. Délissey ou d'A. Gandelot évoquant une construction entreprise par le roi Louis XII.
Depuis le 17e siècle : démolition et transformation
Le plan de Saint-Julien de Baleure en 1575 est la première représentation connue du château, alors doté de ses cinq tours et de la porte Bataillée (non conservée). Les routes vers Dijon et Seurre sont repoussées vers les portes Saint-Nicolas et Madeleine. En 1531, la garnison se compose de 35 hommes d’armes. La citadelle est cédée en 1585 par Henri III à Charles de Lorraine, duc de Mayenne, un des principaux chefs de la Ligue. Subissant des sévices et mauvais traitements (la population doit fournir les vivres à la garnison), la ville se soulève contre les hommes de la Ligue réfugiés au sein de la forteresse. Avec l'aide du maréchal Biron du parti royaliste, elle organise un siège en règle afin de déloger les soldats de la Ligue menés par Edme Regnier de Montmoyen. Leur capitulation a lieu le 26 mars 1595. Henri IV confirme la victoire de la population par la signature de lettres patentes, qui actent aussi la démolition des tours et remparts côté ville par Roger Bellegarde, gouverneur de la province. Le site est démoli entre 1602 et 1606. Malgré l'amputation de sa partie ouest, le château fait partie du programme de restaurations et réparations entrepris en 1609 (suite au procès-verbal dressé par M. Bretagne, lieutenant criminel du bailliage de Beaune, sur l'état des murailles et fortifications de la ville, dans lequel il mentionne les réparations nécessaires à faire). En 1614, la porte extérieure est murée.
Un projet établi par Quinard, architecte-voyer, pour la construction d'une résidence avec jardins et loger le gouverneur en 1737 sur l'esplanade intérieur, est envisagé, mais non réalisé. Au cours de la seconde moitié du 18e siècle, une allée de marronniers est plantée jusqu'à la porte murée, servant de promenade à la population (les portes de ville étant fermées la nuit). Cette esplanade, aliénée du domaine royal en 1778, est adjugée à Jean et Louis Moyne en 1780, avec pour seule contrainte de laisser libre l'allée. En 1793, la réouverture de la porte murée contrarie les commerçants qui craignent de perdre une clientèle préférant passer par ce nouvel accès. A partir de 1820, les parcelles de l'ancien château sont progressivement achetées par Bernard Bouchard. Les deux grosses tours orientales sont aménagées en caves destinées à accueillir des fûts de vin, tandis que les fossés adjacents sont transformés en jardins. En 1869, il obtient l'autorisation de relier les deux "bastions" par une galerie sous la rue du Château. Vers 1880, la famille Bouchard est donc propriétaire du château et de son foncier. La ville a conservé en 1824 deux parcelles (par voie d’expropriation) au bout de la rue pour y installer deux bureaux d'octroi (actuelles parcelles AC 314 et 315 du cadastre). Un pavillon, appelé "petit château", est bâti vers 1830 sur l'esplanade.
La maison Bouchard Père et fils est rachetée en 1995 par la maison de champagne Henriot, groupe établi à Reims depuis 1808, qui entreprend une grande campagne de travaux avec notamment la construction d'une orangerie en 1998.